Le service de santé
des armées dans les Territoires du Sud algérien
(première partie)
André Savelli
L'ŒUVRE humanitaire du service de santé
des armées, si vaste et si dense à travers le monde, sur
les cinq continents, et de façon continue pendant plus d'un siècle,
mériterait d'être mieux connue.
Je n'écrirai, ici, qu'une seule page de cette glorieuse épopée,
celle du service de santé dans les Territoires du Sud algérien
de 1900 à 1976. Je peux en témoigner pour y avoir participé
de 1953 à 1955.
En effet, après une thèse de doctorat en médecine
à Alger et un an d'application à l'hôpital du Val-de-
Grâce à Paris, ma première affectation fut le Sahara.
Toute la promotion partait en Indochine; une dizaine d'entre nous cependant
était détachée, hors cadre, au titre du ministère
de l'Intérieur, avec pour unique mission l'assistance médicale
aux populations sahariennes. En août 1953, je rejoignais mon poste,
l'oasis d'In Salah, 20 000 habitants, y compris les petites oasis périphériques
et les nomades, au coeur du Tidikelt, à 1 000 km au sud d'Alger.
Sahara, vastes horizons, mirages émouvants; immensité plate,
aride et fauve où nomadisent les pasteurs; rares îlots de
verdure - les oasis - où vivent et peinent leurs habitants, les
Harratin, à l'ombre des palmiers. Ceux qui y ont vécu assez
longtemps, officiers, médecins, enseignants, échappent,
par l'intérêt qu'ils portent à leurs recherches dans
ces contrées étranges, au " cafard " dû
au climat et à l'isolement.?
| Sahara, vastes horizons, mirages émouvants; immensité plate, aride et fauve où nomadisent les pasteurs; rares îlots de verdure - les oasis - où vivent et peinent leurs habitants, les Harratin, à l'ombre des palmiers. |
Ainsi, chez nombre d'entre eux, l'âme
s'exalte: c'est l'envoûtement du Sahara bien décrit par Charles
de Foucauld et porté à l'extrême chez Ernest Psichari.
Cet officier incroyant, neveu de Renan, pour qui le désert est
métaphysique, découvre sur cette terre mythique, la présence
divine. Si cette description et ce mysticisme peuvent faire rêver,
la réalité a une autre facette.
Avant l'arrivée des premiers pionniers français
descendus de l'Algérie vers la Croix du Sud, à travers des
étendues à peu près vides, les autochtones, sous-alimentés,
étaient continuellement victimes de la famine, des épidémies
et des pillards. Aucune nation civilisée ne s'était occupée
d'eux.
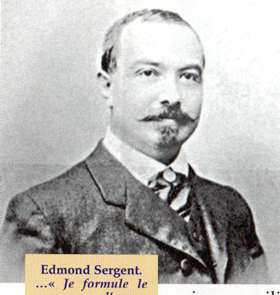 Edmond Sergent |
" Je formule le voeu, écrivait en 1958 le Dr Edmond
Sergent, membre de l'Institut, directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie,
que l'oeuvre de science et de bienfaisance accomplie déjà,
si vaste, par les médecins militaires des Territoires du Sud, serve
de modèle aux médecins appelés à la poursuivre
".C'est cette oeuvre d'assistance médicale que je décris
ci-dessous.
Organisation générale de l'assistance médicale (A. M.)
Dès les premiers temps de l'installation
française en Algérie, vers 1832, et au fur et à mesure
de la pénétration de nos troupes, le commandement avait
le souci de faire assurer les soins aux autochtones dans ses formations
sanitaires, ambulances des colonnes mobiles et hôpitaux de campagne.
Cette pratique avait rencontré un grand succès auprès
des habitants. " Il n'est pas de fait plus solidement établi,
écrivait Lyautey, que l'efficacité du médecin
comme agent de pénétration, d'alliance et de pacification
". On connaît son fameux télégramme à
Gallieni: " Si vous pouvez m'envoyer quatre médecins de
plus, je vous renvoie quatre compagnies ".
Aussi, lors de l'occupation du Sahara, après les combats d'In Salah
et d'In Rhar pour protéger la mission scientifique Flamand- Fein,
en 1900, le corps de santé a poursuivi son oeuvre d'assistance
médicale aux populations.
Direction
Avant 1918, les médecins militaires
détachés dans le grand Sud relevaient des divisions d'Alger,
Oran ou Constantine.
Le décret du 15 février 1918, retardé par la Grande
Guerre, crée une direction du service de santé des Territoires
du Sud, à Alger, dépendante à la fois du Gouvernement
général pour l'assistance médicale indigène
et du commandement pour le service médical des troupes. Le directeur
est chargé d'une mission permanente d'inspection et de contrôle,
de l'étude des questions d'hygiène et d'épidémiologie,
ainsi que de l'examen des projets de construction des établissements
sanitaires et de leurs équipements.
Les médecins
Les médecins sortent tous de l'École du service de santé militaire de Lyon. Le plus souvent débutants, à l'âge des enthousiasmes, ardents et avides d'impressions nouvelles, au bon moral et de santé robuste, ces jeunes médecins étaient bien préparés par une solide formation technique. En effet, après la thèse, ils suivaient une période d'application d'un an au Val de Grâce à Paris; cet enseignement, très dense était agrémenté par l'octroi de quelques places de médecin de théâtre. C'était la fête! Puis départ pour Alger avec un temps d'adaptation d'un mois, afin de se familiariser avec la pathologie locale.
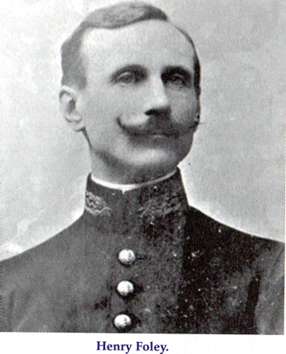 Henry Foley |
 Lucien Baudens |
Là, deux stages de perfectionnement
les attendaient: l'un, au laboratoire saharien de l'Institut Pasteur dirigé
par le Dr Henry Foley, ancien médecin militaire, pour remettre
à niveau leurs connaissances bactériologiques et parasitologiques
; l'autre, à la Clinique ophtalmologique du Pr Larmande à
l'hôpital
universitaire Mustapha, pour y acquérir entre autres
la pratique d'interventions chirurgicales simples, trichiasis et cataractes
pour les plus doués.
À cet égard, il faut signaler que le premier titulaire de
la chaire d'ophtalmologie de la faculté de médecine d'Alger,
fut le Pr Cange, agrégé du Val de Grâce.
Rappelons aussi que la première école de médecine
d'Alger fut créée dès 1832 par Lucien Baudens, chirurgien
des armées, et initialement installée dans les jardins du
Dey, futur hôpital Maillot. Après une éclipse, à
l'instigation d'un élève de Baudens, le médecin colonel
Bertherand, elle redevint école de médecine en 1856, dépendante
de Montpellier jusqu'en 1909, date de son plein exercice, comme faculté.
Ces stages étaient complétés à l'hôpital
Maillot par des gardes de nuit à la maternité
et aussi par une formation stomatologique permettant les soins dentaires
simples, traitement des caries et extractions. Sur place, dans les oasis,
sans électricité pour la plupart, la roulette sera actionnée
par un tour à pied.
Cette préparation s'avérait indispensable pour ces médecins
qui seront isolés dans leur oasis, loin des grands centres techniques,
sans téléphone, ne pouvant compter que sur eux-mêmes.
Mon confrère le plus proche, à Aoulef, se trouvait à
trois heures de piste de tôle ondulée, six heures de pénible
tape-cul aller-retour !
La durée du séjour des médecins, fixée à
deux ans, peut l'être à trois dans les zones climatiques
modérées comme Tamanrasset. Jamais au-delà, car il
était impossible de les faire bénéficier du moindre
congé de détente. Cette relève périodique
répétée a favorisé la réussite du service.
Arrivé en 1953 à In Salah, à 1000 km au sud d'Alger,
je peux attester cette continuité médicale depuis 1900.
Le nombre des médecins militaires s'est accru considérablement
: 20 en 1918, 31 en 1946, 42 en 1950 et 70 en 1960, tous hors cadre, affectés
aux soins des populations.
Les circonscriptions médicales
Les circonscriptions médicales des
Territoires du Sud, 15 en 1918 et 35 en 1960, se répartissent entre
le département des Oasis et celui de la Saoura. Elles sont centrées
sur les établissements de l'assistance médicale, infirmeries
et formations secondaires.
Les infirmeries servent à la fois d'hôpitaux auxiliaires
et de dispensaires pour consultations. La première est créée
en 1905 à Beni Ounif par le médecin-major Henry Foley. Grand
seigneur, séducteur et travailleur acharné, il devint en
1918, le premier directeur du service de santé des Territoires
du Sud avant d'assurer la chefferie des laboratoires sahariens de l'Institut
Pasteur d'Alger de 1922 à 1956.
Quinze infirmeries existent en 1918, 23 en 1928, et à cette époque,
toutes dans des locaux préexistants, en pisé, éclairés
à la lampe à pétrole. Le développement croissant
des besoins oblige l'administration à réaliser un programme
de constructions en dur. Djelfa (1928-1929), Laghouat (1929-1930), Touggourt
et El-Goléa (1934), Colomb-Béchar et Fort Polignac (1936),
Tamanrasset (1937). Après les hostilités, Biskra et Kenadza
(1945), Guerrara dans le M'Zab (1946), Béni-Abbès (1948),
Ouargla et Adrar (1950), Djemaa, Tindouf et Timimoun en 1951. C'est dans
l'oasis rouge de Timimoun, qu'a exercé à cette époque
le médecin général Edmond Reboul quand il était
lieutenant. Lauréat de l'Académie française et de
l'Académie de médecine, son premier livre, Si Toubib (prix
Vérité 1958), relate la vie romancée d'un médecin
militaire au Sahara.
Puis sont construites les infirmeries d'Aoulef et Taghit (1952), Metlililes-Chambas
(1953), In Salah que j'ai inaugurée en 1954, Djanet (1956), Ghardaïa
et Berrian (1958). De plus à Laghouat, après un dispensaire
en 1949, sont créés un pavillon de chirurgie avec une maternité
en 1956, un pavillon de contagieux à Djelfa et une infirmerie -
hôpital de cent lits à El-Oued. Il existait en 1960, vingt-six
infirmeries dispensaires.
Le nombre de lits organisés dans ces établissements varie
d'une dizaine comme à In Salah à 130 à Djelfa. Il
compte, en 1960, plus d'un
millier de lits auxquels s'ajoutent ceux des hôpitaux militaires
de Colomb-Béchar (120) et d'Ouargla (80).
Ces infirmeries sont pourvues de matériel d'exploitation, d'ameublement
des plus modernes et d'un outillage technique de qualité avec salle
d'opération, maternité, pharmacie, laboratoire de microscopie;
vingt-cinq possèdent une installation radiologique.
Les formations secondaires, postes de secours ruraux ou dispensaires anti-ophtalmiques,
sont implantés dans les petites oasis satellites. Ils comportent
un local de consultations et souvent un petit logement pour les infirmiers
auxiliaires. Ces derniers donnent les soins courants entre les visites
médicales et servent d'agents de renseignement sanitaire en cas
de menace d'épidémie ou de malade intransportable.
J'ai le souvenir, à cet égard, de l'infirmier de la petite
oasis d'In Rhar, ayant couru 50 km pour me prévenir qu'un vieillard
semi-comateux n'urinait plus. À la réflexion, il devait
être plus jeune que moi aujourd'hui! Son ventre de femme enceinte
par distension vésicale, justifie la pose d'un cathéter
à travers la paroi abdominale pour vider lentement la vessie. Transport
à l'hôpital d'In Salah; impossible de passer une sonde. J'ai
dû opérer avec mon infirmier-chef au masque à éther
pour l'anesthésie, et le manuel de chirurgie opératoire
tenu devant mes yeux par une infirmière; je n'étais pas
fier! Grâce à Dieu et aux antibiotiques, ce patient guérit.
Dès lors, les consultations augmentèrent bien malgré
moi !
Le nombre de ces dispensaires (les fameux biout el aïnin ou maisons
des yeux), dont l'importance est primordiale en matière de lutte
contre les affections oculaires et surtout le trachome, a été
multiplié : 25 en 1930, 51 en 1940; ils passent à 135 en
1958. Le personnel a progressé en qualité et en quantité.
Jusqu'en 1918, le médecin n'avait qu'un infirmier local, aidé
de quelques hommes de peine.
En 1930, on compte 24 infirmiers et un nombre variable d'auxiliaires,
6 soeurs blanches à Laghouat et 2 à Aïn Sefra.
En 1945 existent 246 personnels dont 135 soignants, et en 1960, 419 dont
13 sages-femmes, 2 assistantes médico-sociales, 41 infirmiers dont
27 soeurs blanches et 363 personnels communaux.
Le fonctionnement de l'assistance médicale
Diversifié, ce fonctionnement permet
d'assurer : les consultations gratuites, les soins aux malades et blessés
dans les infirmeries, la prophylaxie contre les épidémies,
la protection maternelle et infantile, la surveillance médicale
des écoles, le service d'hygiène publique et les travaux
scientifiques.
Les consultations gratuites
90 à 95 % des autochtones, considérés comme indigents
(100 % dans l'oasis d'In Salah) apprécient le service des consultations
gratuites. Les chiffres, en hausse, se passent de commentaire si l'on
considère que la population atteint le million d'habitants grâce
à une démographie enfin positive. Le diagramme des examens
et des soins montre :
- En 1918 un chiffre de 128 643,
- En 1931 un chiffre de 468 735,
- En 1944 un chiffre de 1 813 723
En 1960, près de 3 000 000 de consultations et soins sont donnés
dans les divers établissements sanitaires. Les enfants prédominent
à 50 %, le pourcentage des hommes et femmes s'équilibre.
Depuis 1945, chaque médecin dispose d'un véhicule, vieille
jeep, puis Land-Rover ou 2 CV Citroën, ambulance Peugeot dans les
grands centres, en remplacement du cheval et du chameau. Des tournées
médicales de visites et vaccinations ont lieu en tribus régulièrement
et aussi au moment des rassemblements saisonniers des nomades. C'était
l'occasion de repas plus que frugaux chez les caïds, chefs de villages.
Assis en tailleur sur un vieux tapis à même le sable, nous
partagions un maigre couscous sans viande, un oeuf, quelques dattes et
du thé. Selon l'usage, nous nous efforcions avec le jeune officier
interprète qui m'accompagnait de remercier notre hôte en
émettant des rots au moins aussi sonores que les siens, suivis
d'un " ram'dullah " reconnaissant. À partir de 1951,
six camions équipés en dispensaires circulent dans les localités
dépourvues de poste de secours.
Service hospitalier
L'hospitalisation a été plus difficile à faire rentrer dans les habitudes des populations, surtout pour les femmes. Ne dépassant pas 1 000 en 1918, le chiffre des hospitalisés avait à peine doublé en 20 ans. Dès 1941, grâce à l'augmentation marquée du personnel féminin et des postes sanitaires secondaires, on va enregistrer un mouvement de hausse ininterrompu, passant de 3 000 admissions en 1941 avec 55 000 journées de traitement à 15 000 admissions en 1960 et 245 000 journées. Mais il ne fallait pas s'étonner, après chaque hospitalisation, de trouver le soir une partie de la famille dans la chambre, campant à même le sol sur une natte et participant à la nourriture de leur malade, autour d'un kanoun (petit brasero de terre). Quelle ambiance, quelles odeurs épicées dans ces chambres à trois lits !
(À suivre)
o
L'HISTOIRE
DU SPAHI RAVIN
Jean-Pierre Duhard
" L'histoire du spahi Ravin "
biographie d'un spahi méhariste qui vécut la conquête
française du Sahara entre 1894 et 1907
Éditions Atlantica, 1 volume illustré, 236 pages, 26 €.
Conditions d'auteur aux Algérianistes : 22 € port compris.