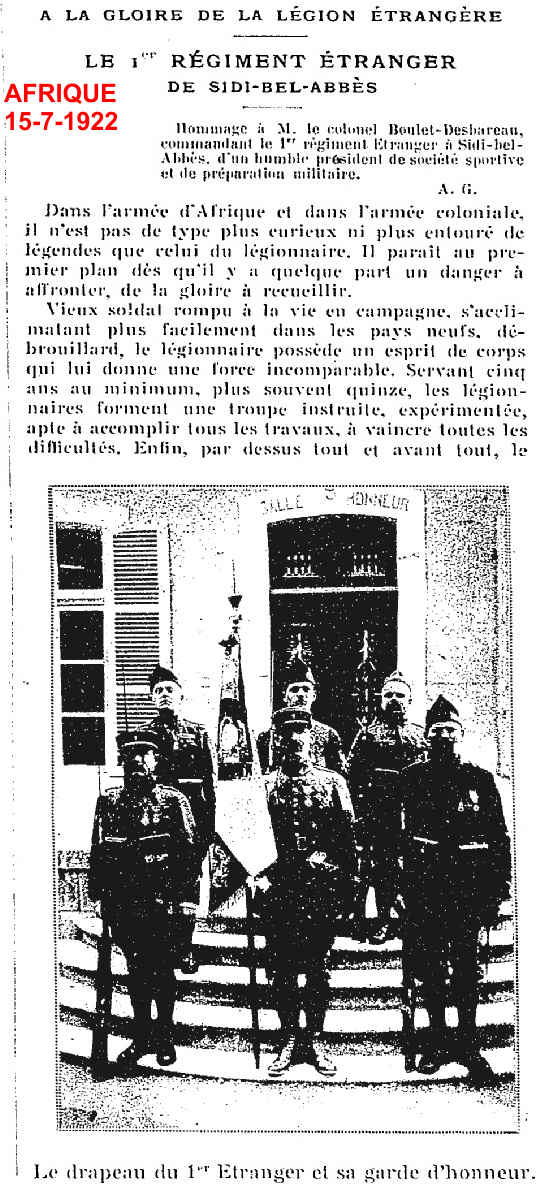
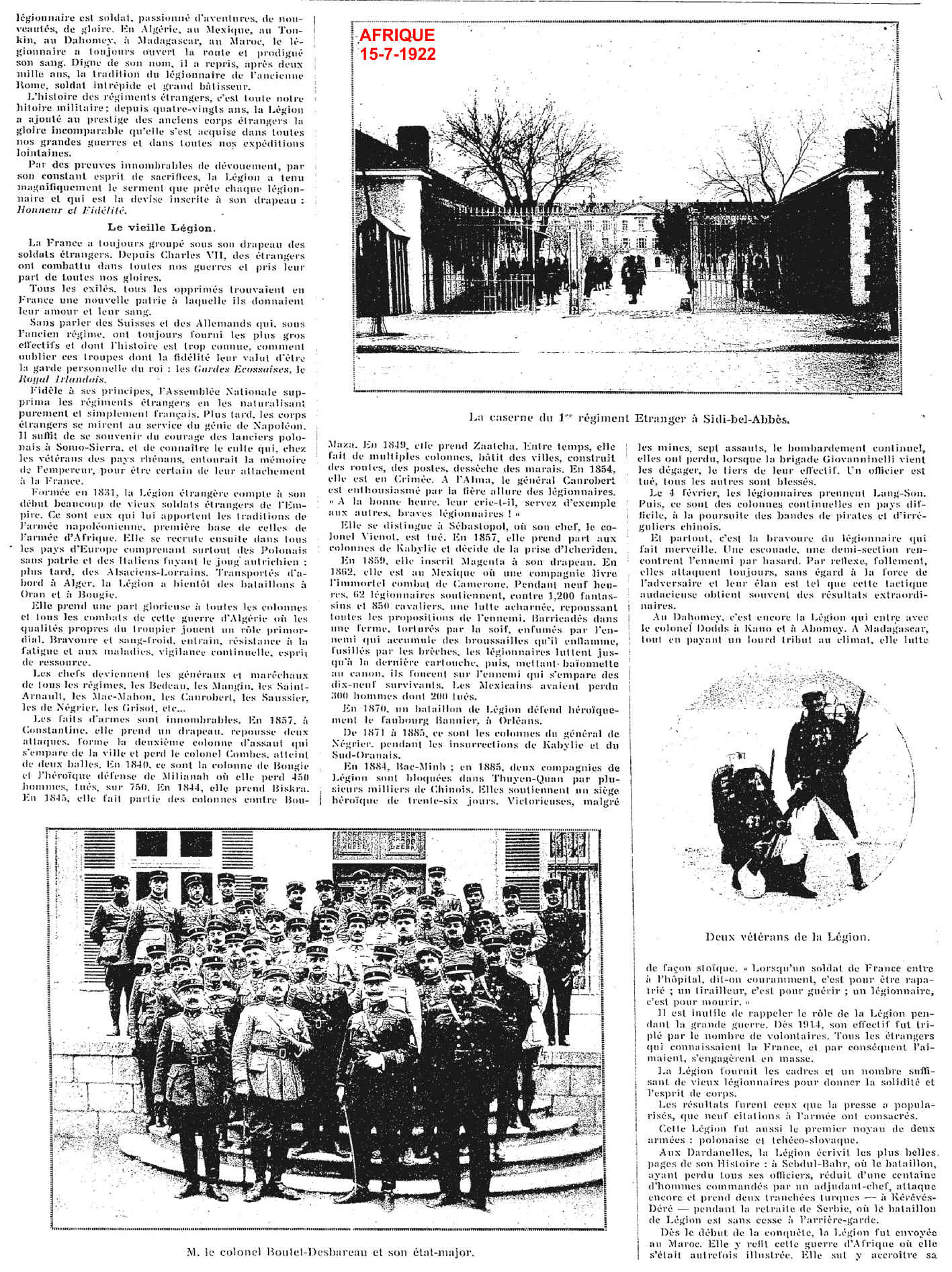

A LA GLOIRE DE LA LÉGION ÉTRANGERE
LE 1er RÉGIMENT ÉTRANGER DE SIDI-BEL-ABBÈS
Hommage à M. le
colonel Boulet-Desbareau, commandant le 1er régiment Étranger
à Sidi-bel-Abbès, d'un humble président de société
sportive et de préparation militaire.
Dans l'armée d'Afrique et dans l'armée coloniale, il n'est
pas de type plus curieux ni plus entouré de légendes que
celui du légionnaire. Il parait au premier plan dès qu'il
y a quelque part un danger à affronter, de la gloire à
recueillir.
Vieux soldai rompu à la vie en campagne, s'acclimatant plus facilement
dans les pays neufs, débrouillard, le légionnaire possède
un esprit de corps qui lui donne une force incomparable. Servant cinq
ans au minimum, plus souvent quinze, les légionnaires forment
une troupe instruite, expérimentée, apte à accomplir
tous les travaux, à vaincre toutes les difficultés. Enfin,
par dessus tout et avant tout, le légionnaire est soldat, passionné
d'aventures, de nouveautés, de gloire. En Algérie, au
Mexique, au Tonkin, au Dahomey, à Madagascar, au Maroc, le légionnaire
a toujours ouvert la route et prodigué son sang. Digne de son
nom, il a repris, après deux mille ans, la tradition du légionnaire
de l'ancienne Rome, soldat intrépide et grand bâtisseur.
L'histoire des régiments étrangers, c'est toute notre
histoire militaire; depuis quatre-vingts ans, la Légion a ajouté
au prestige des anciens corps étrangers la gloire incomparable
qu'elle s'est acquise dans toutes nos grandes guerres et dans toutes
nos expéditions lointaines.
Par des preuves innombrables de dévouement, par son constant
esprit de sacrifices, la Légion a tenu magnifiquement le serment
que prête chaque légionnaire et qui est la devise inscrite
à son drapeau : Honneur et Fidélité.
La vieille Légion.
La France a toujours groupé sous son drapeau des soldats étrangers.
Depuis Charles VII, des étrangers ont combattu dans toutes nos
guerres et pris leur part de toutes nos gloires.
Tous les exilés, tous les opprimés trouvaient en France
une nouvelle patrie à laquelle ils donnaient leur amour et leur
sang.
Sans parler des Suisses et des Allemands qui, sous l'ancien régime,
ont toujours fourni les plus gros effectifs et dont l'histoire est trop
connue, comment oublier ces troupes dont la fidélité leur
valut d'être la garde personnelle du roi : les Gardes Écossaises,
le Royal Irlandais.
Fidèle à ses principes, l'Assemblée Nationale supprima
les régiments étrangers en les naturalisant purement et
simplement français. Plus tard, les corps étrangers se
mirent au service du génie de Napoléon. Il suffit de se
souvenir du courage des lanciers polonais à Somo-Sierra. et de
connaître le culte qui, chez les vétérans des pays
rhénans, entourait la mémoire de l'empereur, pour être
certain de leur attachement à la France.
Formée en 1831, la Légion étrangère compte
à son début beaucoup de vieux soldats étrangers
de l'Empire. Ce sont eux qui lui apportent les traditions de l'armée
napoléonienne, première base de celles de l'armée
d'Afrique. Elle se recrute ensuite dans tous les pays d'Europe comprenant
surtout des Polonais sans patrie et des Italiens fuyant le joug autrichien
; plus tard, des Alsaciens-Lorrains. Transportés d'abord à
Alger, la Légion a bientôt des bataillons à Oran
et à Bougie.
Elle prend une part glorieuse à toutes les colonnes et tous les
combats de cette guerre d'Algérie où les qualités
propres du troupier jouent un rôle primordial. Bravoure et sang-froid,
entrain, résistance à la fatigue et aux maladies, vigilance
continuelle, esprit de ressource.
Les chefs deviennent les généraux et maréchaux
de tous les régimes, les Bedeau, les Mangin, les Saint-Arnault,
les Mac-Mahon, les Canrobert, les Saussier, les de Négrier, les
Grisot, etc....
Les faits d'armes sont innombrables. En 1857. à Constantine.
elle prend un drapeau, repousse deux attaques, forme la deuxième
colonne d'assaut qui s'empare de la ville et perd le colonel Combes,
atteint de deux balles. En 1840, ce sont la colonne de Bougie et l'héroïque
défense de Milianah où elle perd 450 hommes, tués,
sur 750. En 1844, elle prend Biskra. En 1845, elle fait partie des colonnes
contre Bou Maza. En 1849, elle prend Ziiatcha. Entre temps, elle l'ait
de multiples colonnes, bâtit des villes, construit des routes,
des postes, dessèche des marais. En 1854, elle est en Crimée.
A l'Alma, le général Canrobert est enthousiasmé
par la fière allure des légionnaires. " A la bonne
heure, leur crie-t-il, servez d'exemple aux autres, braves légionnaires
! "
Elle se distingue à Sébastopol, où son chef, le
colonel Vienot,. est tué. En 1857, elle prend part aux colonnes
de Kabylie et décide de la prise d'Icheriden.
En 1859, elle inscrit Magenta à son drapeau. En 1862. elle est
au Mexique où une compagnie livre l'immortel combat de Cameronc.
Pendant neuf heures, 62 légionnaires soutiennent, contre 1,200
fantassins et 850 cavaliers, une lutte acharnée, repoussant toutes
les propositions de l'ennemi. Barricadés dans une ferme, torturés
par la soif, enfumés par l'ennemi qui accumule des broussailles
qu'il enflamme, fusillés par les brèches, les légionnaires
luttent jusqu'à la dernière cartouche, puis, mettant-
baïonnette au canon, ils foncent sur l'ennemi qui s'empare des
dix-neuf survivants. Les Mexicains avaient perdu 300 hommes dont 200
tués.
En 1870 un bataillon de Légion défend héroïquement
le faubourg Bannier, à Orléans.
De 1871 à 1885, ce sont les colonnes du général
de Négrier, pendant les insurrections de Kabylie et du Sud-Oranais.
En 1884, Bac-Minh ; en 1885, deux compagnies de Légion sont bloquées
dans Thuyen-Quan par plusieurs milliers de Chinois. Elles soutiennent
un siège héroïque de trente-six jours. Victorieuses,
malgré les mines, sept assauts, le bombardement continuel, elles
ont perdu, lorsque la brigade Giovanninelli vient les dégager,
le tiers de leur effectif. Un officier est tué, tous les autres
sont blessés.
Le 4 février, les légionnaires prennent Lang-Son. Puis,
ce sont des colonnes continuelles en pays difficile, à la poursuite
des bandes de pirates et d'irréguliers chinois.
Et partout, c'est la bravoure du légionnaire qui fait merveille.
Une escouade, une demi-section rencontrent l'ennemi par hasard. Par
réflexe, follement, elles attaquent toujours, sans égard
à la force de l'adversaire et leur élan est tel que cette
tactique audacieuse obtient souvent des résultats extraordinaires.
Au Dahomey, c'est encore la Légion qui entre avec le colonel
Dodds à Kano et à Abomey. A Madagascar, tout en payant
un lourd tribut au climat, elle lutte de façon stoïque.
" Lorsqu'un soldat de France entre à l'hôpital, dit-on
couramment, c'est pour être rapatrié ; un tirailleur, c'est
pour guérir ; un légionnaire, c'est pour mourir. "
Il est inutile de rappeler le rôle de la Légion pendant
la grande guerre. Dès 1914, son effectif fut triplé par
le nombre de volontaires. Tous les étrangers qui connaissaient
la France, et par conséquent l'aimaient, s'engagèrent
en masse.
La Légion fournit les cadres et un nombre suffisant de vieux
légionnaires pour donner la solidité et l'esprit de corps.
Les résultats furent ceux que la presse a popularisés,
que neuf citations à l'armée ont consacrés.
Cette Légion fut aussi le premier noyau de deux armées
: polonaise et tchécoslovaque.
Aux Dardanelles, la Légion écrivit les plus belles pages
de son Histoire : à Sebdul-Babr, où le bataillon, ayant
perdu tous ses officiers, réduit, d'une centaine d'hommes commandés
par un adjudant-chef, attaque encore et prend deux tranchées
turques - à Kérêvés-Déré -
pendant la retraite de Serbie, où lé bataillon de Légion
est sans cesse à l'arrière-garde.
Dès le début de la conquête, la Légion fut
envoyée au Maroc. Elle y refit cette guerre d'Afrique où
elle s'était autrefois illustrée. Elle sut y accroître
sa gloire. Le combat d'Alouana montra combien étaient vivaces
chez elle l'esprit de devoir et de sacrifice. La Légion n'avait
pas dégénéré.
Pendant la guerre, sa tâche y fut particulièrement lourde.
Les troupes d'opération au Maroc avaient été fortement
réduites. La Légion elle-même avait vu partir pour
le front français une grande partie des volontaires n'appartenant
pas aux nations en guerre contre nous.
Les autres furent organisés en bataillon formant corps. Leur
tâche fut énorme. Devant suppléer à l'insuffisance
numérique par leur activité et la rapidité de leurs
mouvements, ces unités ne connurent pas le repos. Les colonnes
succédèrent aux colonnes, les combats, les reconnaissances,
les créations de postes se multiplièrent. II fallait sans
répit soutenir nos partisans, intimider les hésitants
que sollicitait la propagande ennemie, agir vigoureusement et immédiatement
contre les dissidents qui menaçaient l'œuvre entreprise.
La Légion peut être fière de son œuvre dans
ce Maroc qu'elle a contribué à conquérir et qu'elle
nous a gardé.
La Légion d'aujourd'hui.
Depuis plus de trois ans, la guerre est terminée. Au prix de
1,500,000 morts et de 800,000 mutilés, la France a conservé
son indépendance et acquis une gloire immortelle.
Les nations opprimées attendaient sa victoire pour revivre, comptant
sur elle pour les protéger. Dans l'Orient a retenti le vieux
cri de guerre, jamais oublié : Gesta Dei per Francos. Les nations
vaincues ne peuvent plus dire : " Dieu est trop haut, la France
est trop loin. "
La France a assumé la protection de la Syrie. La Victoire 1918
a fait affluer à la Légion de nombreux volontaires de
toutes nationalités.
Tous arrivent au 1er Étranger, à Bel-Abbès. L'instruction
y est poussée activement et le nouvel engagé comprend
bientôt ce qu'est un légionnaire. Quelle que soit son origine,
il est vite amalgamé dans ce creuset qu'est la Légion.
Il voit toutes les différences s'effacer dans une même
discipline, il voit des gradés de sa nationalité qui lui
commandent en français, il entend parler journellement de la
Légion, de son passé, du Maroc, de la Syrie et aussi du
Tonkin. ce paradis du légionnaire. Ses souvenirs antérieurs,
pour beaucoup ceux des dernières années, sont des cauchemars,
s'effacent, il est légionnaire, il en est fier.
Dès qu'il est débrouillé, il est dirigé
sur l'une quelconque des compagnies échelonnées entre
Bel-Abbès et le Guir. Son instruction y est terminée,
il est prêt à faire campagne.
Il était à craindre que cette Légion ne fût
pas à la hauteur de l'ancienne, que les passions politiques ou
nationales ne nuisissent à la solidité de l'édifice,
que la Légion ne fût plus le modèle de loyalisme
qu'elle avait toujours été. Ces craintes furent vaines.
Les légionnaires d'aujourd'hui sont semblables à leurs
anciens. Ils connaissent le même amour des aventures et des pays
neufs.
Ces volontaires, dont beaucoup viennent de se battre pendant sept ans,
sont bientôt impatients de faire campagne et sollicitent leur
envoi sur les T. O. E.
Les faits montrent la façon dont ils s'y conduisent. Au Maroc
: le 21 mars 1921, un détachement de 38 légionnaires de
la 9e Compagnie du 4e Régiment Étranger est attaqué
par surprise à l'Oued-Ouzziat. A la première décharge,
treize légionnaires sont tués et douze sont blessés.
Les treize survivants luttent pendant deux heures, et, malgré
la supériorité numérique de l'ennemi, sous la conduite
de leur lieutenant, enlèvent à la baïonnette la position
de l'adversaire et le mettent en fuite. Ils n'avaient abandonné
ni un blessé, ni un cadavre, ni une arme.
Le 4 septembre 1921, trois bataillons de Légion l'ont partie
du groupe mobile de Bekrit et participent aux opérations du Djebel-Ahroun.
La mission du groupe mobile consiste à s'emparer du massif de
l'Ahroun après avoir occupé le piton de Sidi-Oualar et
la croupe de l'Ajgou. Le terrain à parcourir est inconnu en grande
partie. D'après les renseignements recueillis, l'ennemi est décidé
à opposer une forte résistance.
Les unités chargées de la prise de Sidi-Ouatar quittent
le bivouac à 3 h. 30, et à 6 h. 15. après un irrésistible
assaut à la baïonnette, occupent leur objectif.
A 9 heures, l'attaque de l'Ajgou se déclanche ; le combat, rapidement
mené, permet à nos troupes d'assurer la conquête
définitive de la croupe à 9 h. 30.
A 16 heures, les généraux Poeymireau et Rheveney sont
sur le sommet de l'Ahroun.
Grâce à l'instruction, à la discipline et au courage
des troupes engagées, celle opération importante fut rapidement
menée avec des pertes très minimes.
Au Levant.
Le 4e Bataillon du 4e Etranger fournit 100 volontaires pour exécuter
un coup de main sur un village rebelle. Le détachement fait une
marche de dix heures pour gagner sa base de départ. Il fait une
nouvelle marche de quinze heures en pays montagneux et hostile pour
atteindre son objectif, accomplit sa mission à la baïonnette
et ramène 21 prisonniers. Ce coup d'audace vaut aux officiers,
sous-officiers et légionnaires du détachement dix-sept
citations à l'ordre de la brigade.
La vieille Légion eût-elle l'ait mieux ? Le 6 novembre
1921, le 1er Régiment Étranger envoie au Tonkin un bataillon
qui occupe Lang-Son, Na-Cham, Cao-Bang, la région limitrophe
de la province chinoise du Quang-Si où règne depuis un
an la guerre civile avec toutes les misères qu'elle entraîne.
Des troupes du Quang-Si passent la frontière et projettent d'attaquer
Lang-Son le jour de Noël. Apprenant l'arrivée des légionnaires
à Lang-Son, ils renoncent à leur attaque, tant est redoutée
la Légion en Extrême-Orient.
Le 6 janvier 1922, une petite colonne de 100 légionnaires, commandée
par le capitaine Thomas et le lieutenant Blanquet,. est chargée
de nettoyer la région entre Dong-Dong el Na-Cham.
Sans pertes, le capitaine Thomas accomplit sa mission, tuant 40 pirates
dont un chef important porteur de documents inédits et s'emparant
d'un drapeau qui porte en langue annamite l'inscription suivante : Troupe
de la reprise de l'Annam, 2e Bataillon, 3e' Régiment, Chef de
Bataillon Sa-Qinh. "
La tradition est renouée. La conduite des légionnaires
sur tous les fronts, leurs nombreuses citations permettent d'être
fier de l'œuvre accomplie.
Un chef qui a vu la Légion à l'œuvre, le général
Aubert, a résumé dernièrement son appréciation
dans l'éloge suivant : " C'est la meilleure troupe, européenne,
solide, brave et manœuvrière ; elle s'est toujours montrée
à la hauteur des circonstances les plus critiques. "
Au Maroc, en Syrie, comme à la frontière chinoise, le
légionnaire sait, toujours mourir héroïquement comme
jadis ce sous-officier de Taxa, en criant : " Vive la France !
Vive la Légion ! " La vieille et grande musique de la Légion
fut de de tous temps l'auréole de la Ville qui l'abrite. Les
artistes qui la composent ont fait d'elle un symbole qui subsistera
toujours et qui l'a placée une des premières de noire
belle France.