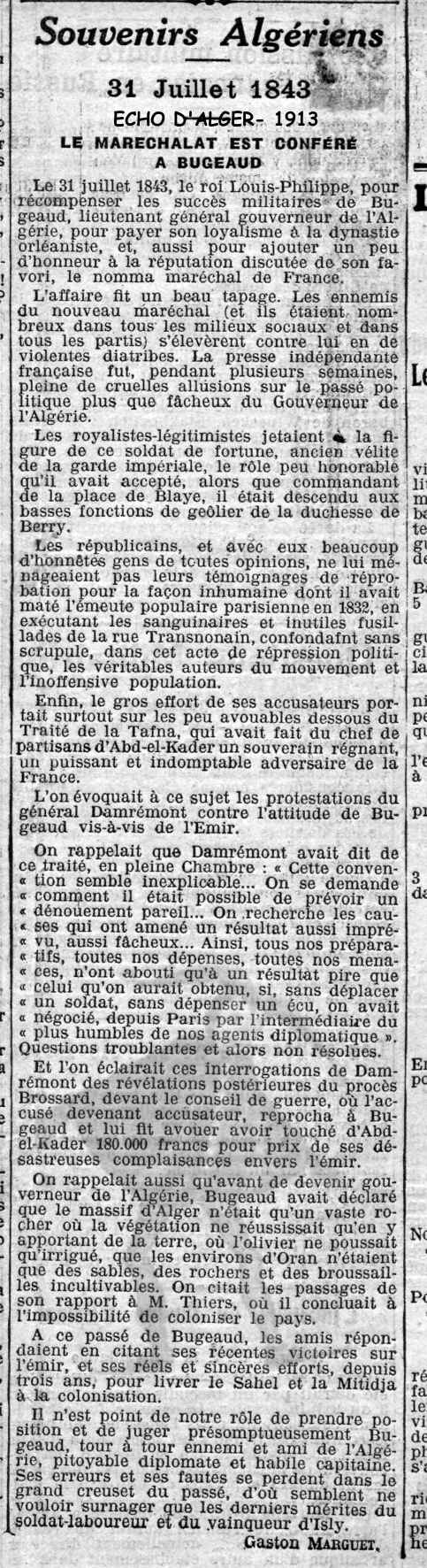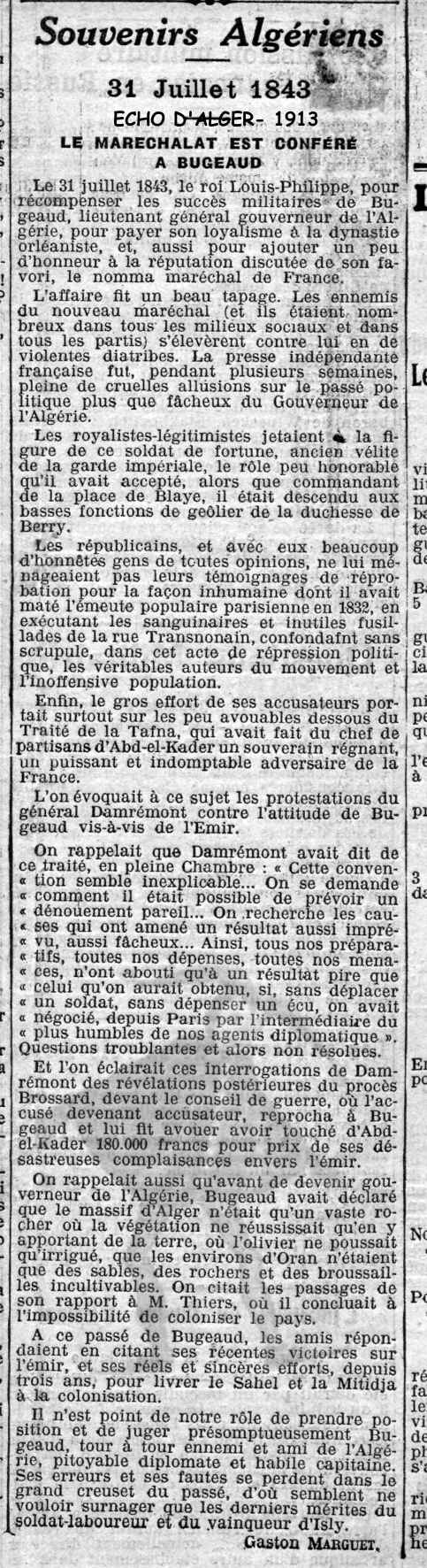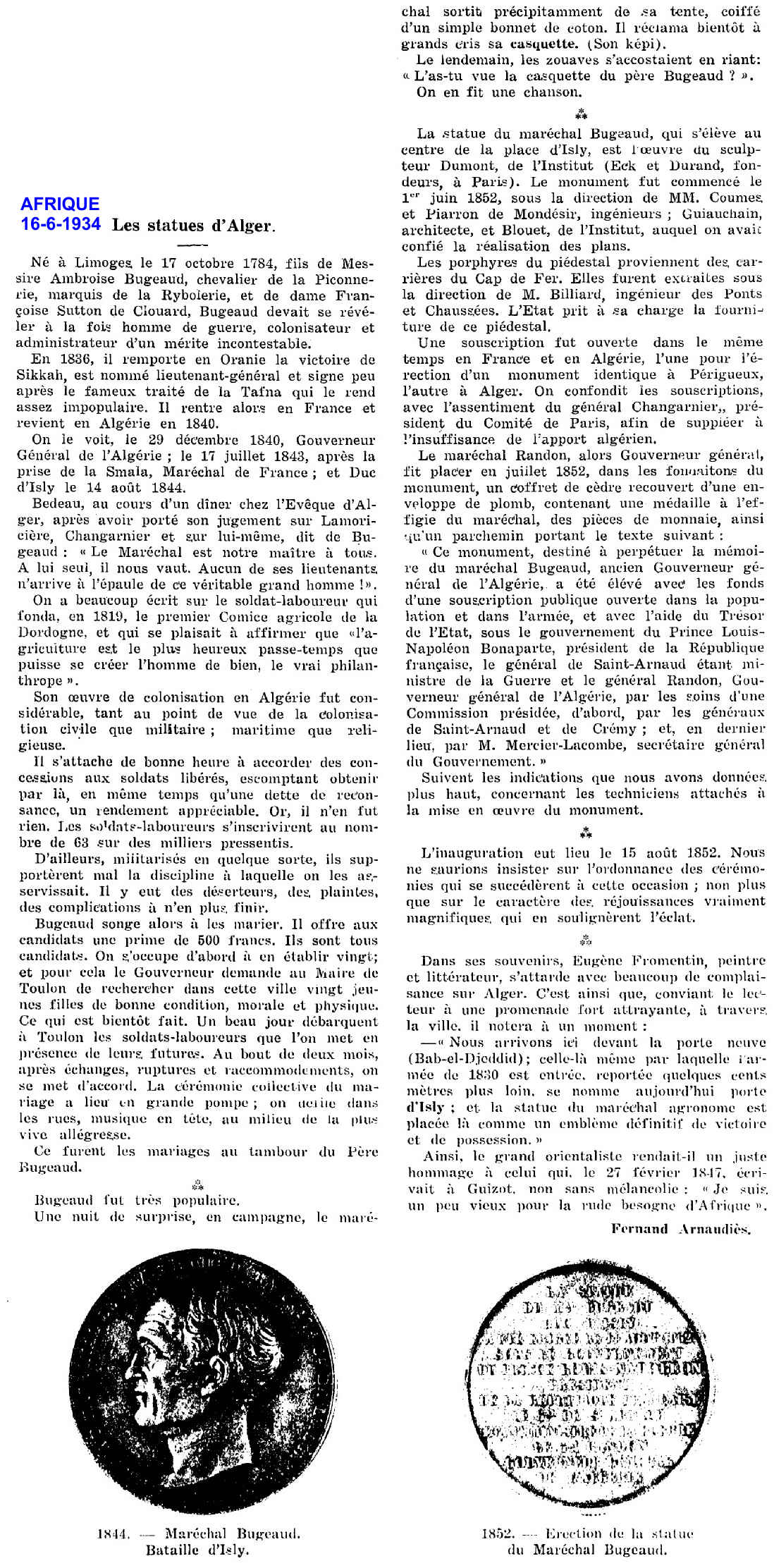
Les statues d'Alger.
Né à Limoges
le 17 octobre 1784, fils de Messire Ambroise Bugeaud, chevalier de la
Piconnerie, marquis de la Rybolerie, et de dame Françoise Sutton
de Clouard, Bugeaud devait se révéler à la fois
homme de guerre, colonisateur et administrateur d'un mérite incontestable.
En 1836, il remporte en Oranie la victoire de Sikkah, est nommé
lieutenant-général et signe peu après le fameux
traité de la Tafna qui le rend assez impopulaire. Il rentre alors
en France et revient en Algérie en 1840.
On le voit, le 29 décembre 1840, Gouverneur Général
de l'Algérie ; le 17 juillet 1843, après la prise de la
Smala, Maréchal de France ; et Duc d'Isly le 14 août 1844.
Bedeau, au cours d'un dîner chez l'Évêque d'Alger,
après avoir porté son jugement sur Lamoricière,
Changarnier et sur lui-même, dit de Bugeaud : " Le Maréchal
est notre maître à tous. A lui seul, il nous vaut. Aucun
de ses lieutenants n'arrive à l'épaule de ce véritable
grand homme !".
On a beaucoup écrit sur le soldat-laboureur qui fonda, en 1819,
le premier Comice agricole de la Dordogne, et qui se plaisait à
affirmer que "l'agriculture est le plus heureux passe-temps que
puisse se créer l'homme de bien, le vrai philanthrope ".
Son œuvre de colonisation en Algérie fut considérable,
tant au point de vue de la Colonisation civile que militaire ; maritime
que religieuse.
Il s'attache de bonne heure à accorder des concessions aux soldats
libérés, escomptant obtenir par là, en même
temps qu'une dette de reconnaissance, un rendement appréciable.
Or, il n'en fut rien. Les soldats-laboureurs s'inscrivirent au nombre
de 63 sur des milliers pressentis.
D'ailleurs, militarisés en quelque sorte, ils supportèrent
mal la discipline à laquelle on les asservissait. Il y eut des
déserteurs, des plaintes, des complications à n'en plus
finir.
Bugeaud songe alors à les marier. Il offre aux candidats une
prime de 500 francs. Ils sont tous candidats. On s'occupe d'abord à
en établir vingt ; et pour cela le Gouverneur demande au Maire
de Toulon de rechercher dans cette ville vingt jeunes filles de bonne
condition, morale et physique. Ce qui est bientôt fait. Un beau
jour débarquent à Toulon les soldats-laboureurs que l'on
met en présence de leurs future.?. Au bout de deux mois, après
échanges, ruptures et raccommodements, on se met d'accord. La
cérémonie collective du mariage a lieu en grande pompe;
on défile dans les rues, musique en tête, au milieu de
la plus vive allégresse.
Ce furent les mariages au tambour du Père Bugeaud.
Bugeaud fut très populaire.
Une nuit de surprise, en campagne, le maréchal sortit précipitamment
de sa tente, coiffé d'un simple bonnet de coton. Il réclama
bientôt à grands cris sa casquette. (Son képi).
Le lendemain, les zouaves s'accostaient en riant: " L'as-tu vue
la casquette du père Bugeaud ? ".
On en fit une chanson.
La statue du maréchal Bugeaud, qui s'élève au centre
de la place d'Isly, est l'œuvre du sculpteur Dumont, de l'Institut
(Eck et Durand, fondeurs, à Paris). Le monument fut commencé
le 1° juin 1852, sous la direction de MM. Coumes et Piarron de Mondésir,
ingénieurs ; Guiauchain, architecte, et Blouet, de l'Institut,
auquel on avait confié la réalisation des plans.
Les porphyres du piédestal proviennent des carrières du
Cap de Fer. Elles furent extraites sous la direction de M. Billiard,
ingénieur des Ponts et Chaussées. L'État prit à
sa charge la fourniture de ce piédestal.
Une souscription fut ouverte dans le même temps en France et en
Algérie, l'une pour l'érection d'un monument identique
à Périgueux, l'autre à Alger. On confondit les
souscriptions, avec l'assentiment du général Changarnier,
président du Comité de Paris, afin de suppléer
à l'insuffisance de l'apport algérien.
Le maréchal Randon, alors Gouverneur général, fit
placer en juillet 1852, dans les fondations du monument, un coffret
de cèdre recouvert d'une enveloppe de plomb, contenant une médaille
à l'effigie du maréchal, des pièces de monnaie,
ainsi qu'un parchemin portant le texte suivant :
" Ce monument, destiné à perpétuer la mémoire
du maréchal Bugeaud, ancien Gouverneur général
de l'Algérie, a été élevé avec les
fonds d'une souscription publique ouverte dans la population et dans
l'armée, et avec l'aide du Trésor de l'État, sous
le gouvernement du Prince Louis-Napoléon Bonaparte, président
de la République française, le général de
Saint-Arnaud étant ministre de la Guerre et le général
Randon, Gouverneur général de l'Algérie, par les
soins d'une Commission présidée, d'abord, par les généraux
de Saint-Arnaud et de Crémy ; et, en dernier lieu, par M. Mercier-Lacombe,
secrétaire général du Gouvernement. "
Suivent les indications que nous avons données plus haut, concernant
les techniciens attachés à la mise en oeuvre du monument.
L'inauguration eut lieu le 15 août 1852. Nous ne saurions insister
sur l'ordonnance des cérémonies qui se succédèrent
à cette occasion ; non plus que sur le caractère des réjouissances
vraiment magnifiques qui en soulignèrent l'éclat.
Dans ses souvenirs, Eugène Fromentin, peintre et littérateur,
s'attarde avec beaucoup de complaisance sur Alger. C'est ainsi que,
conviant le lecteur à une promenade fort attrayante, à
travers la ville, il notera à un moment :
" Nous arrivons ici devant la porte neuve (Bab-el-Djeddid) ; celle-là
même par laquelle l'armée de 1830 est entrée, reportée
quelques cents mètres plus loin, se nomme aujourd'hui porte d'Isly
; et la statue du maréchal agronome est placée là
comme un emblème définitif de victoire et de possession.
"
Ainsi, le grand orientaliste rendait-il un juste hommage à celui
qui, le 27 février 1S17, écrivait à Guizot, non
sans mélancolie : " Je suis. un peu vieux pour la rude besogne
d'Afrique ".